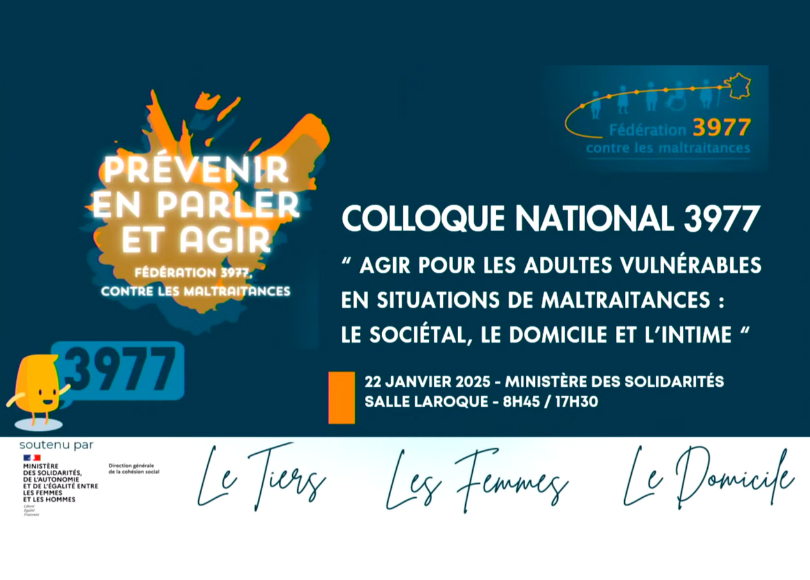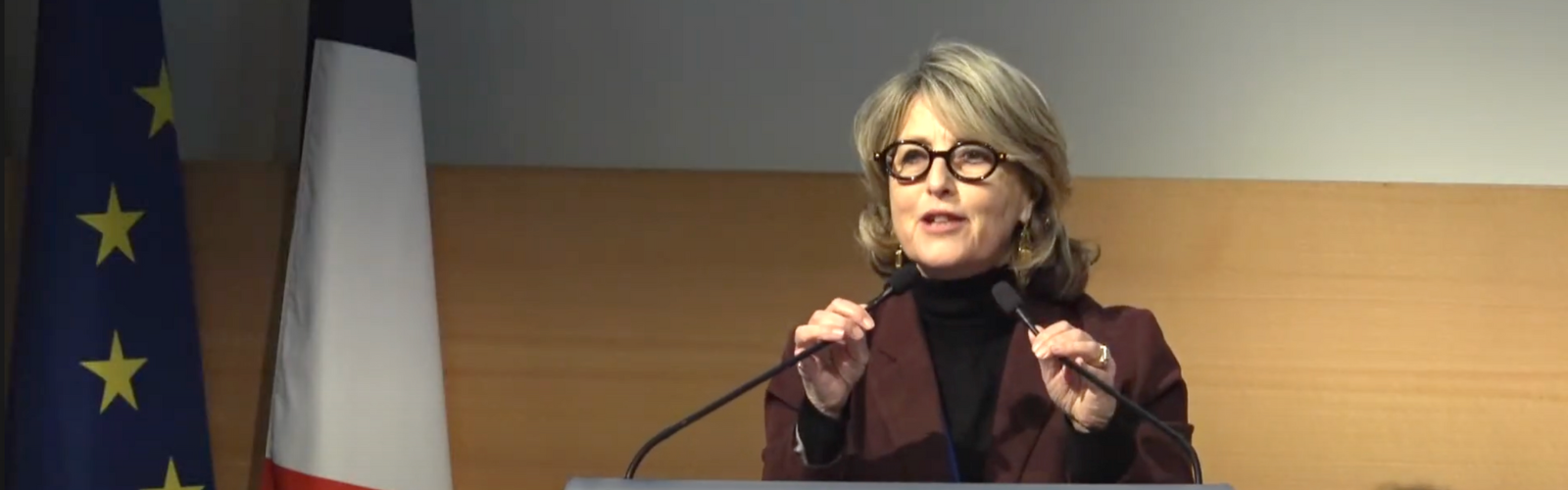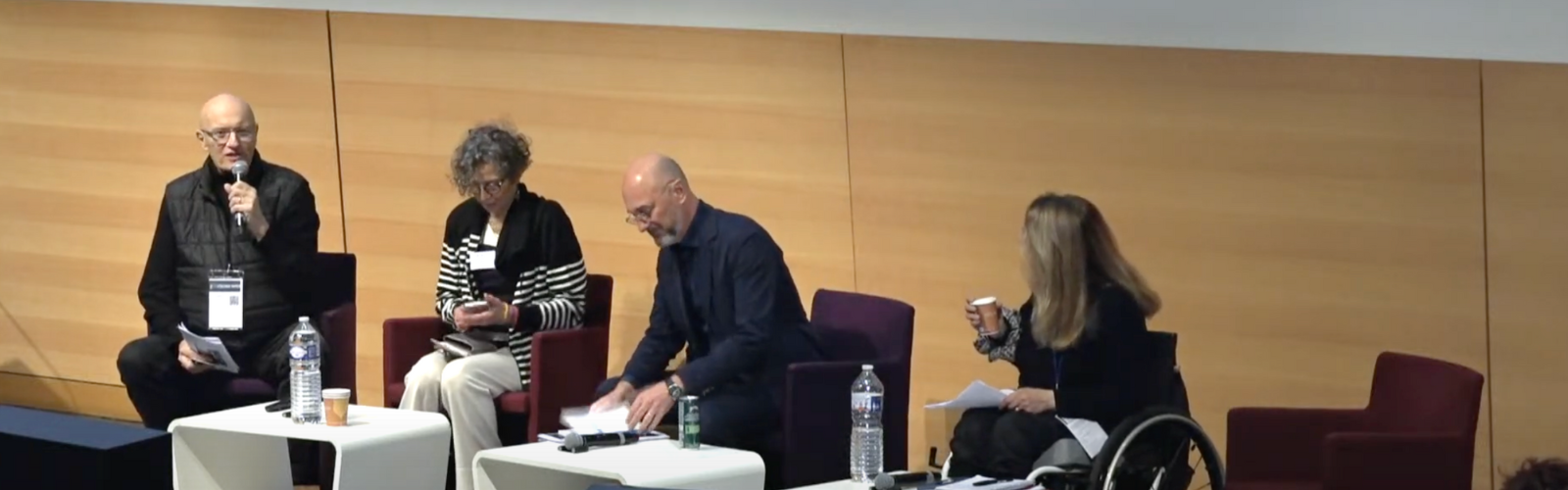Le tiers associatif et écoutant, un acteur essentiel dans la lutte contre les maltraitances

L'éthique du soi et de l'altérité
Sophie Moulias, docteur en éthique et médecin gériatre gérontologue, aborde les enjeux éthiques liés à la pratique médicale dans le contacte des soins aux personnes âgées.
Dans la relation médecin-patient, la dignité humaine et la nécessité de la rencontre avec l'autre doivent être les fondements de l’échange. La posture du médecin n’est pas uniquement d’examiner un patient mais de développer une posture multidisciplinaire, principe même de l’éthique.
L’éthique n’apporte aucune solution ; elle ne pose que des questions. Elle invite à interroger les postures de bienfaisance, de non-malfaisance qui consiste à ne pas vouloir faire de tort à l’autre pour son bien, de respect de l’autonomie du sujet et d’équité.
Quel rôle alors du tiers-médecin ? De plus en plus pris à témoin par le patient ou les proches, il est de plus en plus un conciliateur mais pour être force de propositions, il ne doit pas être seul. Son impartialité doit lui permettre de veiller à la qualité des soins, à dépister les mauvais traitements, à éduquer les professionnels, les familles et les personnes elles-mêmes, à sensibiliser au respect de la parole du sujet. Or, il y a de moins en moins de médecins et la formation laisse peu de place aux sensibilisations sur les violences hors celles des femmes et des enfants et si on ajoute de surcroît les problèmes de bureaucratisation des soins... Le temps est une ressource essentielle. Ne pas le prendre renforce la toute-puissance du sachant et donc le risque pour le médecin de ne relever que la vulnérabilité du patient et limiter sa responsabilisation.
S’appuyer sur les dispositifs existants pour favoriser une action concrète et efficace
Elle mentionne l'existence d'un institut des vulnérabilités et rappelle l'importance de connecter les différents acteurs dont l’institut de la Fédération 3977 pour favoriser une approche restaurative lors de l'analyse des situations de vulnérabilité.
L’autonomie, un appel des soutiens et des tiers
Fabrice Gzil, philosophe assure la codirection de l’espace éthique d’Ile de France. Il aborde la manière dont nous interagissons avec les autres et comment ces interactions peuvent à la fois soutenir et entraver l'autonomie individuelle.
Il est intéressant de noter que, traditionnellement, le respect d'autrui est souvent associé à une attitude de non-ingérence. Cependant, il nous invite à réfléchir à la complexité de cette notion. En effet, le véritable respect ne se limite pas à rester en retrait ; il implique également d'être présent et de soutenir les autres dans leur cheminement vers l'autonomie.
Les trois formes d'autonomie qu'il décrit — fonctionnelle, morale et civile — montrent bien que l'autonomie n'est pas un état isolé, mais un processus qui nécessite des interactions et des soutiens. Cela soulève également des défis, notamment dans des contextes de maltraitance ou d'isolement, où l'absence de tiers de confiance peut aggraver la vulnérabilité des individus.
La question des tiers, qu'ils soient proches ou extérieurs, est donc cruciale. Notre autonomie est souvent liée à notre capacité à établir des relations de confiance. En ce sens, l'engagement pour la lutte contre les maltraitances est fondamental, car il vise à créer un environnement où chacun peut se sentir en sécurité et soutenu dans son parcours.
L’exemple de la Province du Québec
Anne Marie Savard, professeure et chercheuse à la faculté de droit de Laval, conclut le colloque avec l’exemple du traitement de la question de la maltraitance envers les aînés au Québec.
En 2017, la Province a adopté une loi pour lutter contre cette maltraitance, en réponse à des scandales passés impliquant des abus dans des institutions. Elle distingue la maltraitance institutionnalisée, souvent due à des défaillances dans la gouvernance, de la maltraitance systémique, qui découle de modes de gestion inappropriés. Le rapport de 2008, "Préparons l'avenir avec nos aînés", a été un tournant en plaçant la lutte contre la maltraitance comme une priorité.
La loi de 2017 a deux vertus : symbolique, en affirmant que la maltraitance est inacceptable, et effective, en définissant clairement la maltraitance et en établissant des procédures pour traiter les plaintes. Depuis son adoption, le nombre de signalements a considérablement augmenté, ce qui indique une meilleure dénonciation des cas de maltraitance, même si des études supplémentaires seront nécessaires pour évaluer l'effectivité réelle de la loi.
Malgré cette augmentation significative, elle aborde une posture d’humilité en en rappelant qu’il est essentiel d'améliorer la qualité de vie des aînés. Le système de santé actuel, trop centré sur les soins hospitaliers, ne répond pas aux besoins des personnes âgées, souvent atteintes de maladies chroniques. La société doit repenser son approche du vieillissement et des soins à domicile pour favoriser une meilleure intégration sociale des aînés. A quand un mouvement old lives matter ? C’est clairement par la modification de notre regard et de notre considération de la vieillesse et des personnes âgées que des changements profonds et substantiels pourront être faits pour améliorer leur sort, non pas pour qu'elles vieillissent moins mal, mais plutôt pour qu'elles vieillissent de la plus belle des manières dans nos sociétés.